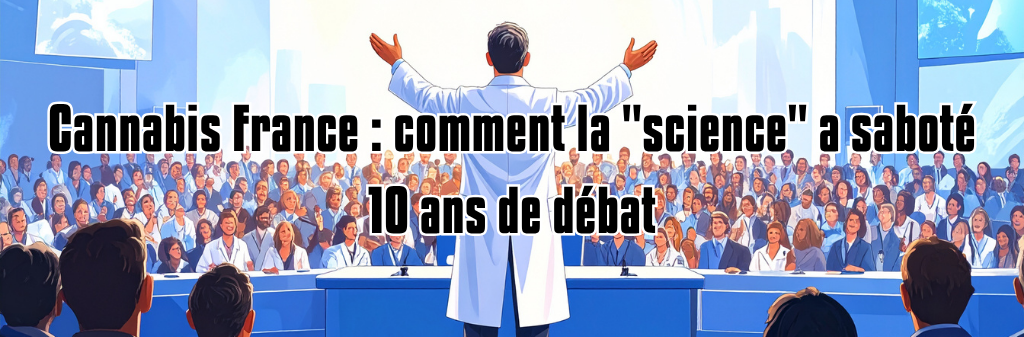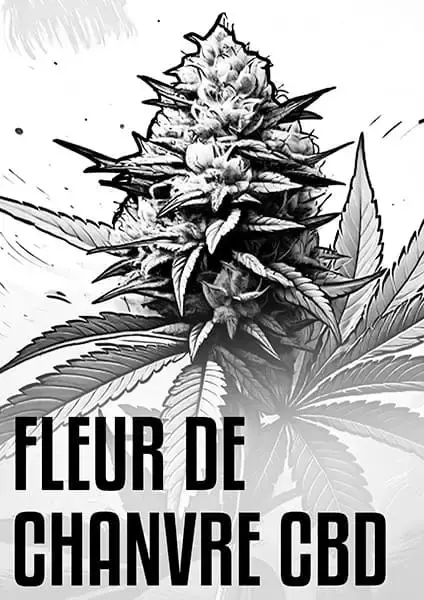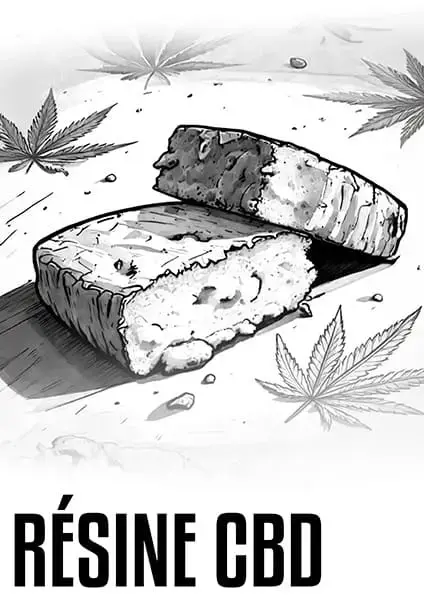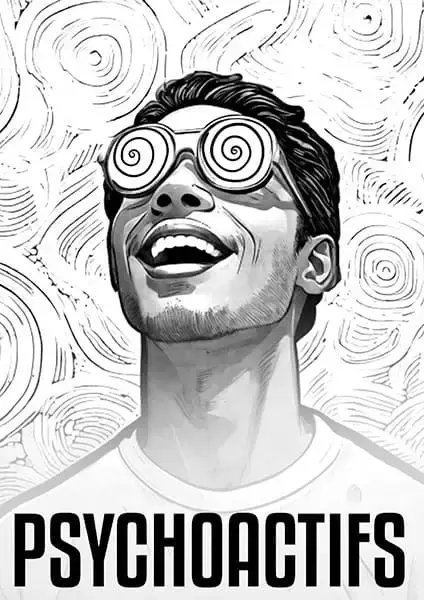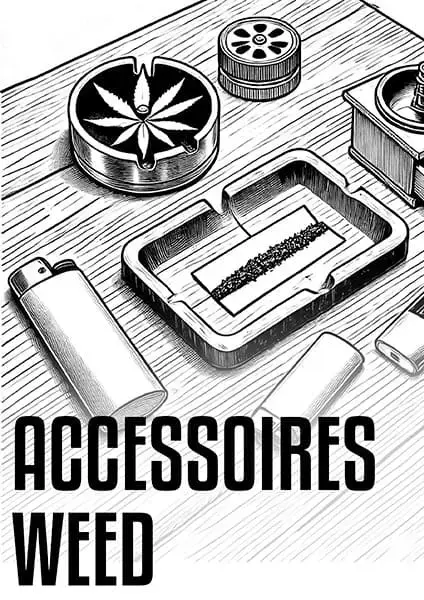Alors que de nombreux pays européens avancent vers la régulation du cannabis, la France reste figée dans une posture punitive, alimentée par des discours anxiogènes souvent plus idéologiques que scientifiques. Au cœur de ce blocage : Jean Costentin, figure médiatique dont l’autorité masque des positions contestées. Retour sur une manipulation de la vérité qui a coûté dix ans de progrès au débat français sur le cannabis.
Bienvenue dans le Gardenz, encore une fois vous êtes en bonne compagnie !
SOMMAIRE :
Jean Costentin, figure d’autorité ou illusion d’expertise ?
En France, chaque fois que la question du cannabis resurgit dans le débat public — que ce soit à propos de la légalisation du cannabis à usage récréatif, de l’expérimentation du cannabis thérapeutique, ou de la simple consommation de cannabis par les jeunes adultes — un nom revient inlassablement sur les plateaux télé : Jean Costentin. Présenté comme expert, professeur de pharmacologie et membre émérite de l’Académie nationale de médecine, il jouit d’un statut d’autorité que peu osent remettre en question. Pourtant, son rôle dans le blocage du débat autour de l’usage de cannabis en France mérite d’être interrogé — et critiqué.
Car Jean Costentin n’est pas qu’un scientifique : c’est un acteur politique. Ses prises de position contre la légalisation du cannabis en France dépassent très largement le cadre neutre de la recherche académique. En multipliant les déclarations alarmistes, souvent déconnectées des consensus internationaux et des travaux publiés par des organismes comme l’OFDT, il a influencé durablement la perception française du cannabis, en particulier sur ses prétendus effets irréversibles sur le cerveau, la motivation ou la santé mentale. Ses interventions sur les dangers du cannabis récréatif laissent peu de place à la nuance, et amalgament trop souvent consommation régulière, addiction sévère et maladies psychiatriques, sans distinguer les profils de consommateurs, les variétés de cannabis, ni les quantités de cannabis consommées.
Ce positionnement rigide a façonné une politique française du cannabis centrée sur l’interdiction, la répression, et la peur — à rebours de l’évolution observée ailleurs en Europe, où plusieurs pays, comme le Luxembourg, l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore le Canada, ont fait le choix d’un accès au cannabis plus encadré, voire d’un marché légal du cannabis à visée médicale ou récréative. Dans l’Union européenne, la France reste en queue de peloton, avec l’une des politiques les plus dures sur la détention de cannabis, malgré des taux de consommation parmi les plus élevés. Chaque année, des centaines de milliers de consommateurs de cannabis, souvent âgés de 18 à 64 ans, s’exposent à des peines, alors même que l’efficacité de la répression est remise en question, notamment à travers les saisies de cannabis, qui restent dérisoires face au volume consommé du cannabis en France.
Dans ce contexte, le discours pseudo-scientifique de Costentin agit comme une caution morale, un écran de fumée qui justifie des choix politiques figés, retarde la légalisation, et pénalise les patients, les chercheurs, les médecins, les usagers, et plus largement la santé publique. À force de confondre convictions personnelles et vérités scientifiques, il contribue à figer le débat, au détriment d’une approche basée sur les données, la réduction des risques, et la reconnaissance de la diversité des usages du cannabis en France — qu’ils soient thérapeutiques, récréatifs, ou simplement sociaux.
En somme, Jean Costentin n’est pas un observateur neutre : il est un acteur idéologique qui a freiné, parfois sciemment, toute évolution du cadre légal du cannabis en France. Et à ce titre, il est urgent de questionner la légitimité qu’on lui accorde encore dans le débat actuel, alors même que la France peine à rejoindre le mouvement européen vers la légalisation du cannabis à des fins thérapeutiques et récréatives.
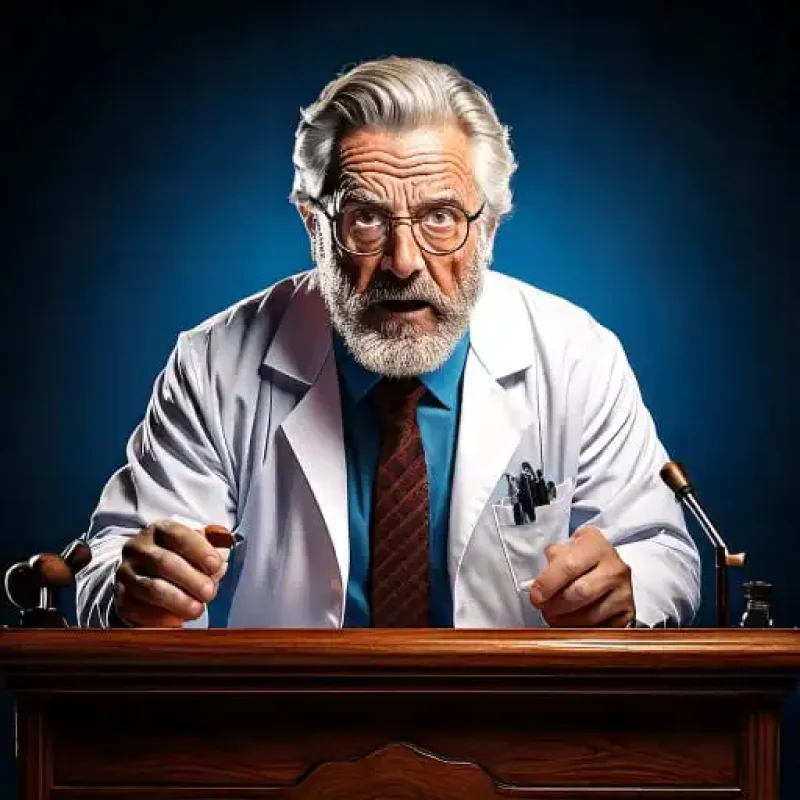
Des affirmations pseudo-scientifiques relayées comme vérité absolue
Derrière son apparente autorité, Jean Costentin s’est surtout illustré par une série de déclarations publiques qui relèvent davantage de l’opinion personnelle que de l’analyse scientifique rigoureuse. Le problème ? Ces propos sont systématiquement repris par les médias généralistes comme des faits scientifiques incontestables, alors qu’ils sont souvent contestés, obsolètes ou biaisés.
Dans plusieurs interventions, Costentin affirme par exemple que fumer du cannabis réduit le QI, pousse à la schizophrénie, ou constitue la porte d’entrée vers toutes les drogues en France. Ces discours alarmistes ignorent délibérément la complexité des cas individuels, les facteurs de vulnérabilité psychologique, ou encore le contexte de consommation. Il n’est jamais question des quantités de cannabis, des fréquences d’usage, ni de l’environnement social ou médical du consommateur. Le cannabis devient une substance démoniaque, sans nuance.
Ce type d’amalgames est d’autant plus problématique qu’il alimente les peurs et bloque toute expérimentation du cannabis thérapeutique. À force de lier usage de cannabis et pathologie mentale de manière systématique, on invalide la légitimité même d’un cannabis médical en France, pourtant déjà utilisé dans plusieurs pays de l’Union européenne avec des résultats cliniques documentés. Alors que l’expérimentation du cannabis thérapeutique a été timidement lancée en France, Costentin continue à semer le doute sur son efficacité, en mélangeant sans distinction CBD, THC, et produits dérivés du cannabis.
Ses positions ne sont d’ailleurs pas soutenues par les principales institutions de recherche, à commencer par l’OFDT, qui propose une lecture plus nuancée de l’usage de cannabis en France.

L’organisme rappelle régulièrement que la consommation régulière concerne surtout une minorité de consommateurs de cannabis, souvent jeunes, et qu’il convient de mieux cibler les actions de prévention, plutôt que de criminaliser l’ensemble des usagers. En niant cette réalité, Costentin invisibilise des stratégies de santé publique plus efficaces, comme la réduction des risques, l’éducation aux produits, ou la différenciation entre usage occasionnel et usage problématique.
Pire encore, ses propos sont souvent déconnectés du cours réel des données scientifiques européennes. Tandis que des pays comme le Canada, le Luxembourg ou récemment l’Allemagne ont ouvert l’accès au cannabis légal, avec une régulation stricte et un contrôle sur le marché du cannabis, la France continue de s’enliser dans un modèle punitif, largement nourri par les discours rétrogrades de figures comme Costentin. Résultat : des millions d’adultes français consomment du cannabis dans l’illégalité, avec des produits non contrôlés, au détriment de leur santé, de la justice, et de l’économie.
En somme, les discours de Costentin ne relèvent pas de la science mais du dogme. Et c’est précisément ce glissement dangereux entre opinion morale et expertise médicale qui entretient la confusion, bloque le développement du marché légal du cannabis en France, et retarde la mise en place de politiques plus humaines, plus efficaces, et plus alignées sur les réalités européennes.
Un usage politique délibéré de son discours pour bloquer la légalisation
En France, le débat sur le cannabis n’a jamais été purement scientifique : il est profondément politique. Et c’est précisément dans cette zone grise entre expertise médicale et idéologie d’État que Jean Costentin a su s’imposer comme une figure stratégique, utilisée pour valider des choix politiques conservateurs, au moment même où d’autres pays de l’Union européenne choisissaient de légaliser le cannabis, ou d’en autoriser l’usage thérapeutique dans un cadre médical strict.
Plutôt que d’alimenter une réflexion honnête sur l’expérimentation de l’usage thérapeutique du cannabis, ses interventions ont été reprises par des responsables politiques pour justifier l’immobilisme français. On l’a vu dans plusieurs rapports parlementaires, dans des tribunes publiées dans la presse, ou encore dans des auditions officielles à l’Assemblée nationale : Costentin est présenté comme l’expert ultime, dont les avertissements servent à bloquer tout assouplissement de la législation. Son discours devient une arme rhétorique, un prétexte commode pour ne pas agir en faveur d’un marché du cannabis encadré, même lorsque les preuves scientifiques, économiques et sanitaires s’accumulent en faveur de cette réforme.
Ce positionnement arrange bien les gouvernements successifs, qui préfèrent saisir la peur plutôt que construire une politique cohérente autour du cannabis. Pendant ce temps, les patients français en attente d’un accès au cannabis médical sont contraints de s’approvisionner illégalement, de se tourner vers des filières non sécurisées ou de renoncer à un traitement pourtant reconnu ailleurs en Europe. La France devient un cas d’école du blocage par l’autorité, où la lenteur administrative et la frilosité politique se dissimulent derrière des avis soi-disant scientifiques, en réalité profondément orientés.
Ce verrouillage idéologique orchestré avec l’aide de figures comme Jean Costentin a eu des conséquences concrètes : le marché du cannabis médical en France est quasi inexistant, l’expérimentation lancée en 2021 peine à produire ses premiers résultats, et les produits à base de cannabis comme le CBD restent soumis à des interprétations juridiques floues, malgré les rappels de la Commission européenne sur leur libre circulation au sein du marché intérieur.
Plus grave encore, ce climat a gelé les avancées en santé publique. Alors que d’autres pays investissent dans la recherche sur les dérivés du cannabis, sur les usages thérapeutiques et les effets à long terme selon les profils, la France reste centrée sur le triptyque interdit / puni / stigmatisé. Dans cette configuration, l’obsession du risque prime sur toute logique de réduction des risques, et les jeunes adultes français continuent à fumer un cannabis non contrôlé, souvent trop dosé en THC, avec des résines de mauvaise qualité, parfois coupées, au mépris de leur santé publique.
En s’appuyant sur un seul homme pour figer une politique, la France a retardé sa propre évolution de plus d’une décennie. Pendant que l’Allemagne, le Luxembourg ou encore le Canada construisent des modèles d’accès légal au cannabis, la France continue à criminaliser l’usage, à gonfler les statistiques de détention, et à laisser le trafic prospérer, sans jamais remettre en question les fondements mêmes de cette stratégie.

L’impact concret : 10 ans de débat scientifique et sociétal perdus
La France ne manque ni de consommateurs de cannabis, ni de chercheurs, ni de médecins ouverts à l’étude de ses usages. Ce qui lui manque cruellement, c’est un cadre légal cohérent, et la volonté politique de dépasser les dogmes. En s’arc-boutant sur des figures comme Jean Costentin, qui présentent des opinions comme des vérités absolues, le pays a tout simplement perdu une décennie d’évolution dans la compréhension, la régulation et l’usage du cannabis.
Pendant que les autres pays de l’UE avançaient, la France restait figée. Entre 2010 et 2020, le Canada a légalisé le cannabis récréatif, l’Allemagne a mis en place un système de cannabis médical, le Luxembourg a autorisé la culture personnelle, et même des bastions prohibitionnistes comme l’Italie ou la Suisse ont initié des expérimentations contrôlées. La France, elle, en était encore à discuter la définition juridique du CBD, pendant que les saisies de cannabis en France ne cessaient d’augmenter… sans pour autant faire baisser la consommation régulière.
Ce retard a des répercussions à tous les niveaux. Sur le plan médical, des milliers de patients atteints de pathologies chroniques, de douleurs neuropathiques ou de cancers n’ont toujours aucun accès sécurisé au cannabis thérapeutique, malgré le lancement de l’expérimentation du cannabis médical en France en 2021. Celle-ci, censée durer deux ans, a déjà pris du retard, faute de moyens, de volonté claire, et d’un encadrement à la hauteur. Au mois de décembre 2023, seule une fraction des professionnels de santé avait été formée, et la majorité des patients n’avait pas encore pu intégrer le dispositif.
Sur le plan économique, le marché du cannabis en France reste à l’état embryonnaire. Pendant que d’autres pays structurent des filières agricoles, créent des emplois et taxent la vente de cannabis, la France reste empêtrée dans la répression et la saisie de plants de cannabis, sans jamais aborder la culture légale comme une opportunité. Pourtant, le potentiel économique est immense : en régulant le marché du cannabis légal, en encadrant les dérivés du cannabis et en investissant dans la recherche, la France pourrait créer un secteur stratégique à l’échelle européenne. Mais elle préfère continuer à interdire, punir, dissuader, sans agir sur le fond.
Et sur le plan sociétal, les effets sont encore plus préoccupants. En criminalisant encore les usagers de cannabis, en envoyant devant la justice des adultes pour détention de quelques grammes, en marginalisant les jeunes issus des quartiers populaires pour un usage souvent banal, la France entretient un système inégalitaire, inefficace et contre-productif. Le service public de santé se trouve démuni face à une substance omniprésente, sans outils de prévention modernes, ni discours adapté à la réalité des jeunes consommateurs. Et tout cela, en partie, parce qu’une poignée d’acteurs a réussi à imposer sa vision rétrograde du cannabis, comme si elle était gravée dans le marbre.
En somme, à force de confondre prudence et paralysie, la France a reculé pendant que l’Europe avançait. Et ce retard ne se mesure pas seulement en années, mais en dommages concrets : patients oubliés, jeunes stigmatisés, chercheurs démotivés, opportunités économiques perdues. Le prix du dogme se compte aujourd’hui en vies impactées, en inégalités accrues, en science étouffée.

Pourquoi il est dangereux de laisser une seule voix façonner l’opinion publique
La force de Jean Costentin, ce n’est pas tant la qualité de ses recherches — souvent contestées — que la place qu’il occupe dans le débat sur le cannabis en France. Pendant plus de vingt ans, il a été l’unique visage médiatique associé à la science du cannabis. Sur les plateaux télé, dans les journaux, à la radio, il est celui que l’on appelle pour “expliquer les risques”, rassurer le politique, ou alerter l’opinion publique. Une position hégémonique, dangereuse par nature.
Dans un pays aussi complexe que la France, avec ses multiples usages du cannabis, ses variétés consommées, ses modèles de consommation très diversifiés, confier la parole à un seul homme revient à confisquer le débat. Cela empêche la confrontation d’idées, écrase les voix dissidentes, et retarde la circulation d’un savoir plus pluraliste. La réalité, c’est que l’usage de cannabis en France ne peut pas être résumé à un unique discours. Il y a des patients, des jeunes, des adultes, des usagers réguliers, des expérimentateurs occasionnels, des professionnels de santé, des chercheurs, tous porteurs d’expériences et de données précieuses.
Mais dans les grands médias français, aucune place n’est faite à ces récits alternatifs. Pas de chercheurs de l’INSERM, pas de spécialistes de réduction des risques, pas d’associations d’usagers ou de patients du cannabis thérapeutique. Et trop rarement, les analyses de l’OFDT ou les perspectives européennes sont évoquées. Cette concentration du discours autour de Costentin a enfermé la France dans une vision univoque, dépassée, où le cannabis reste assimilé à une drogue dure, un danger absolu, une substance à interdire sans nuance.
Ce phénomène a aussi décrédibilisé la parole scientifique auprès du public. Car lorsque les citoyens constatent un décalage entre le discours catastrophiste véhiculé par une autorité comme Costentin, et leur propre expérience du produit — souvent bien moins dramatique —, ils finissent par rejeter l’ensemble du discours médical. C’est ainsi que naît une fracture de confiance entre science et société, alors même que le rôle de la recherche devrait être de clarifier, d’accompagner, d’informer avec rigueur.
Enfin, cette situation empêche l’émergence de solutions politiques pragmatiques. Plutôt que de penser un accès au cannabis encadré, d’agir sur le marché noir, de protéger les mineurs, ou de réguler les produits à base de cannabis, on reste piégé dans une opposition stérile entre interdiction totale et la peur d’un chaos cannabique. Ce faux dilemme, alimenté par une parole unique, dessert la santé publique, la recherche scientifique, et les intérêts des citoyens français.
Il est urgent, aujourd’hui, d’ouvrir les micros, les tribunes et les décisions à la pluralité des expertises. Et de reconnaître que laisser un seul homme incarner toute la pensée française sur le cannabis, c’est un risque démocratique majeur, doublé d’une erreur stratégique dans un domaine où les enjeux sont sanitaires, économiques et sociaux.
Vers une reprise en main du discours scientifique sur le cannabis en France
Après des années de confusion, de prophéties alarmistes et de blocage idéologique, il devient urgent de reprendre le contrôle du discours scientifique autour du cannabis en France. Ce travail ne peut plus être monopolisé par une seule voix, surtout lorsque celle-ci manque de rigueur, ignore les consensus internationaux, et sert davantage un agenda politique que l’intérêt public.
Heureusement, cette reprise en main est déjà en cours, portée par des chercheurs, des médecins, des institutions publiques et des acteurs associatifs qui œuvrent, souvent dans l’ombre, à réintroduire des faits, des données, et de la nuance dans le débat. L’OFDT produit régulièrement des analyses précises sur les usages du cannabis en France, en croisant les données épidémiologiques avec les réalités sociales et territoriales. L’INSERM, de son côté, publie des revues détaillées sur les effets du cannabis thérapeutique, sur les usages à risque, ou encore sur les profils des consommateurs de cannabis, du plus ponctuel au plus régulier.
Des voix s’élèvent aussi dans le champ médical pour défendre une expérimentation sérieuse du cannabis à des fins thérapeutiques. Des praticiens hospitaliers réclament un cadre clair, des produits sûrs, et surtout un accès facilité pour les patients, sans passer par des procédures kafkaïennes. Ce mouvement est soutenu par une partie de l’opinion publique, qui comprend que l’interdiction absolue n’a jamais protégé la santé, et que fumer du cannabis ou en consommer sous forme de dérivés médicaux n’a pas les mêmes implications, ni les mêmes besoins en termes d’encadrement.
Du côté européen, la dynamique est tout autre. La Commission européenne, tout comme plusieurs pays membres de l’UE, soutient une approche plus rationnelle, fondée sur la santé publique, la régulation du marché, et la lutte contre le trafic, plutôt que contre les usagers. Le Luxembourg, l’Allemagne, les Pays-Bas, ou encore le Portugal ont déjà entamé ce virage, parfois même avec des modèles hybrides mêlant culture personnelle, vente encadrée, et suivi médical. Ces expériences, observables sur plusieurs mois voire années, offrent des enseignements concrets, qui devraient servir de base de comparaison pour la France.
Pour cela, il faut redonner la parole à la diversité des experts, inclure les sciences sociales, la santé publique, les professionnels du soin, mais aussi les usagers eux-mêmes, souvent mieux placés pour témoigner des effets réels des variétés de cannabis, de leurs usages, et des risques associés. Car oui, il y a des risques. Mais c’est précisément en les documentant honnêtement qu’on peut mieux les prévenir, mieux les encadrer, et proposer une alternative crédible à la prohibition.
Cette reprise en main est aussi un enjeu générationnel. Les jeunes Français, qui grandissent dans un monde où le cannabis légal est déjà une réalité dans plusieurs pays, ne peuvent plus accepter les mensonges grossiers, les comparaisons douteuses, ou les campagnes de peur à l’ancienne. Ils réclament de la transparence, de la cohérence, et surtout une politique qui soit à la hauteur des enjeux actuels — qu’il s’agisse de santé mentale, de justice sociale, ou de libertés individuelles.
En somme, il est temps que la France rejoigne enfin le mouvement européen, et qu’elle cesse de se lier à des figures d’un autre temps, qui ont confondu autorité avec monopole de la parole. Car le cannabis en France mérite mieux qu’un discours figé : il mérite une science vivante, pluraliste, rigoureuse, capable de guider une véritable politique de santé publique.

FAQ – Ce que tu dois retenir sur le cannabis et la France
Pourquoi Jean Costentin est-il critiqué dans le débat sur le cannabis en France ? Parce qu’il a longtemps été présenté comme expert neutre alors que ses propos sont marqués par une vision idéologique. Ses positions exagèrent souvent les risques liés à l’usage de cannabis, sans distinction entre usage thérapeutique, récréatif ou abusif. Cela a contribué à bloquer la légalisation du cannabis en France, malgré l’évolution observée dans d’autres pays d’Europe.
Le cannabis est-il vraiment illégal en France ? Oui, le cannabis récréatif reste interdit. La possession, la culture et la vente sont punies par la loi. Seule une expérimentation du cannabis médical en France est en cours depuis 2021, sous conditions très strictes. Le CBD, quant à lui, est autorisé sous certaines limites de THC. Le marché du cannabis en France reste donc limité et fortement encadré.
Quels sont les risques réels liés à la consommation de cannabis ? Comme toute substance psychoactive, le cannabis présente des risques, surtout en cas de consommation régulière, précoce ou non encadrée : troubles de la mémoire, troubles anxieux, dépendance possible. Mais ces effets dépendent de nombreux facteurs : âge, quantité de cannabis, variétés consommées, état de santé, contexte social. Une régulation permettrait justement de mieux prévenir ces risques.
La France est-elle en retard sur le cannabis par rapport au reste de l’Europe ? Oui. De nombreux pays européens comme l’Allemagne, le Luxembourg ou les Pays-Bas ont déjà légalisé ou régulé l’accès au cannabis, que ce soit à des fins médicales ou récréatives. En comparaison, la France maintient une politique de prohibition rigide, malgré une consommation de cannabis élevée chez les jeunes et les adultes.
Qu’est-ce que l’expérimentation du cannabis thérapeutique en France ? Lancée en 2021, cette expérimentation permet à certains patients souffrant de maladies graves d’accéder à des produits à base de cannabis sous contrôle médical. Mais son déploiement reste lent, limité en nombre de participants et freiné par des résistances administratives et politiques.
Peut-on espérer une légalisation du cannabis en France dans les années à venir ? Cela dépendra du courage politique et de la capacité à dépasser les discours dogmatiques. Tant que des figures comme Jean Costentin continueront à monopoliser le débat public avec des propos alarmistes, le changement restera difficile. Mais la pression de l’opinion, les données scientifiques et l’évolution européenne rendent la légalisation du cannabis en France de plus en plus inévitable.